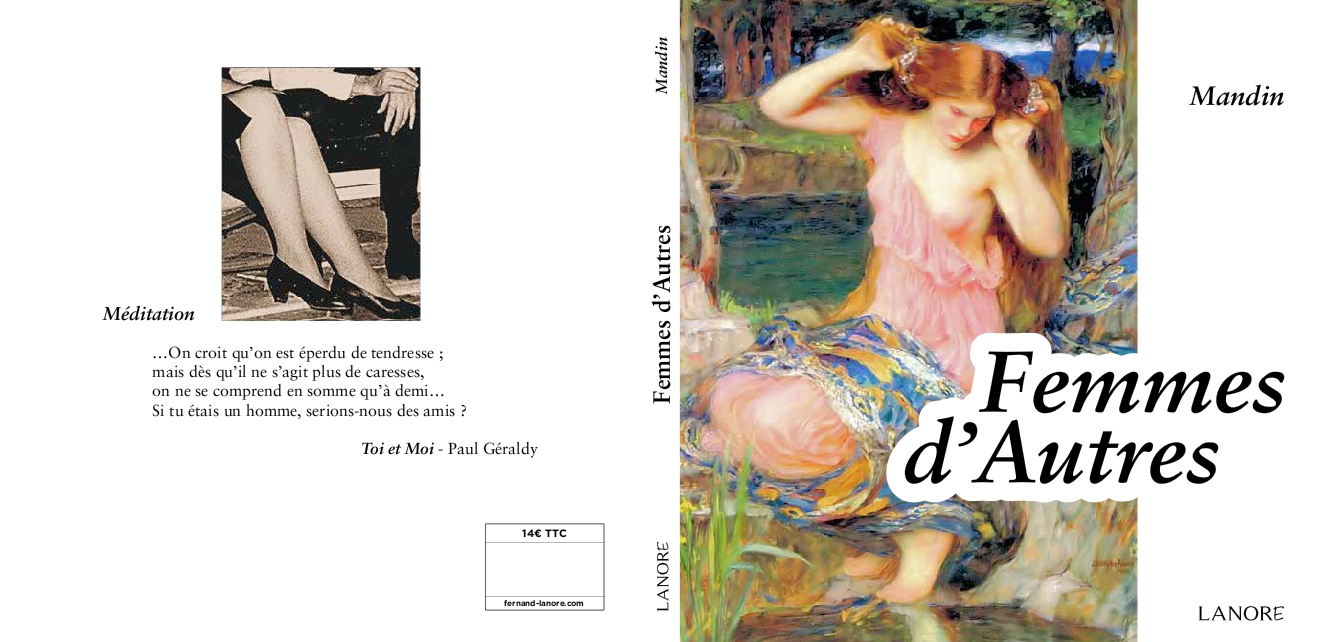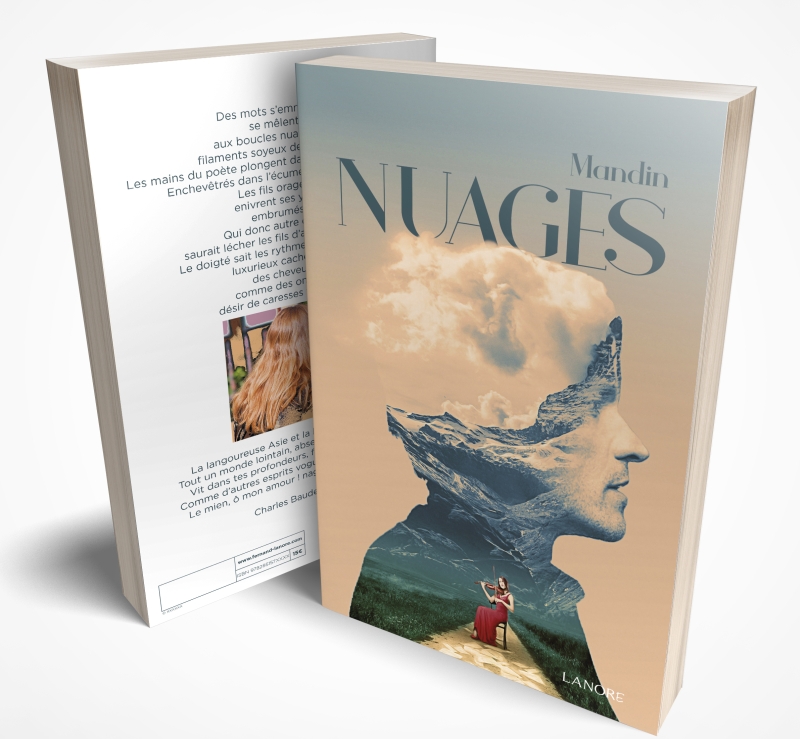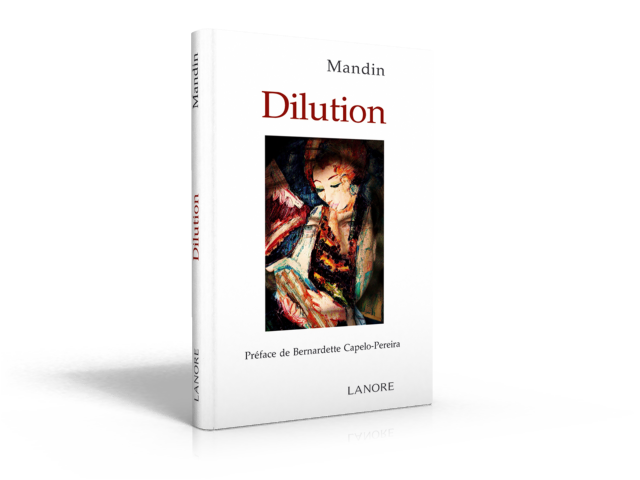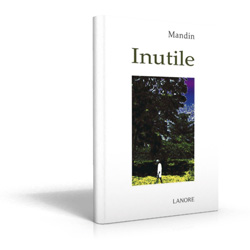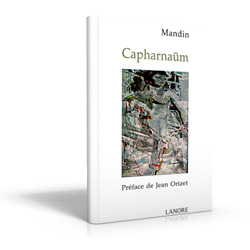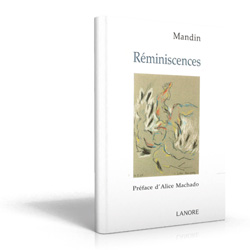Intervention de Claude Tuyéras – Soirée Mandin, Les Mardis Littéraires – Le 5 Mars
Les Mardis Littéraires de Jean-Lou Guérin
Soirée Mandin, le 5 Mars 2013 à 20h15
Le 5 Mars 2013, devant plus d’une cinquantaine de personnes, des extraits « d’Inutile », de « Réminiscences » et de « Capharnaüm » de Mandin, ont été lus par Chantal Jego, Christian Merlette, Fabian Ferrari et Thierry Boeuf.
Vidéo de l’intervention de Claude Tuyéras à la soirée Mandin
Transcription de l’intervention de Claude Tuyéras
« Ecrire, c’est apporter de l’eau à une source
pour qu’elle découvre sa soif. » (Jean-Louis Giovannni, Pas Japonais, Unes, 1991)
Je ne connaissais pas Mandin. Je l’ai rencontré par ses textes, par un heureux hasard – les hasards sont des coups de dé – dans la distance, dans le silence ; j’ai immédiatement conversé avec ses mots, avec cette langue si plastique, ouverte à l’insolite, sans tabous, que l’on parcourt dans Réminiscences ou Capharnaüm. Plus je lisais ces pages, plus j’avais le sentiment qu’il fallait lire encore, relire, parce que la lecture d’un recueil est une fouille, une approche désordonnée qui, au bout d’un moment, montre son véritable attrait. Cette écriture m’a séduit, touché, m’a fait découvrir un poète authentique.
Mais je viens parler de son dernier recueil, Inutile, ou plus exactement, je viens dire ici, assis à la gauche du poète pour cette soirée qui lui est consacrée, comme elle l’est à la poésie, je viens dire, donc, comment Inutile me parle, nous parle. On peut, à propos de cette œuvre, partir de ce postulat, de ce titre provocateur, énigmatique, sans déterminant, qui en fait un mot ouvert à tous les possibles, à ce « tout » évoqué p.111, qui s’adresse au « tu », et donc à tout le monde, à ce mot enfin qui renvoie inévitablement à son antonyme. Alors, Inutile est-il un paradoxe, en ce sens qu’ériger une œuvre apparaîtra à chacun comme une activité « utile », ou simplement une aspiration à nous interroger sur cette contradiction entre l’utile et l’inutile, peut-être surannée ?
En effet, ces adjectifs qui apparaissent vers le XIIe siècle opposent l’avantageux à ce qui ne l’est pas, particulièrement dans le domaine du droit, y compris du droit religieux. L’utile et le vain ! Mais le profit, la valeur, la possession, l’usufruit et l’appropriation sont déjà les fondements de l’édifice de l’utile ; autant dire que ce concept est une invention mercantile, et qu’elle peut paraître parfaitement arbitraire. Montaigne écrivait : « Il n’y a rien d’inutile dans la nature, non pas même l’inutilité. » (Essais, III, ch. 1).
Mandin nous demande comment aborder l’utilité (?) d’un sourire, d’un regard, d’un poème, sans l’inutilité de ce qui les motive, et de ce qui s’y rattache. On a alors le sentiment qu’il n’y a plus de séparation entre l’utile et l’inutile : « c’est une goutte d’air liquide / entre l’utile et l’inutile / que le poète vise fréquemment », écrit-il p. 109. Soit le propos les conjugue, comme ici l’air et l’eau, soit il se place entre, dans la page 111, par exemple : « éparpille / les noirs / les gris / et les blancs / tu les poses / l’un à l’autre / l’autre à l’un » ; l’éparpillement se conjugue ainsi à l’ordre (« poses »), doublement avec la symétrie, et les « gris » se placent entre les pigments contraires : entre et ensemble. Il y a aussi l’image du « centre », confirmée souvent par la disposition typographiques des vers dans les pages. Par ailleurs, dans le recueil, « l’avantageux » n’apparaît pas plus que le « nuisible » ; ces mots ne sont pas utilisés. (Est-ce à dire qu’ils sont inutiles ?) Cependant l’important bestiaire renvoie inévitablement à des figures traditionnelles de l’inutile : la « vipère », « l’araignée », le « rapace » ou les insectes, notamment… Les superstitions – et autres – les ont inscrites dans le sacerdoce de l’inutile. Le poète les fait renaître et les projette pour construire finalement une importante métaphore de l’écriture poétique : le mouvement, le glissement, les liens qui se tissent, s’éparpillent, s’envolent ( verbe récurrent, auquel on peut associer les utilisations symboliques – et qui font songer à la poésie japonaise – de ce beau « papillon » « sur la langue », ou de cette « libellule » qui court le risque de connaître jusqu’à se perdre sur une croix presque reliquaire, comme on le lit p. 153). Comment ne pas considérer alors le poème comme une « aventure » (même page), ce poème qui doit aussi invectiver le lecteur ? Il faut, nous dit Mandin, que les « farauds » disparaissent, et retrouver une forme de renaissance, quitte à « gommer » si besoin, afin aussi de « perdre la page suivante », formule remarquable (p.33), une perte créatrice, par conséquent.
D’autre part, cette antonymie, que le titre implicitement suggère, chez un poète qui admire l’œuvre de Baudelaire, fonde également une des caractéristiques principales de l’écriture de Mandin, et donne une grande cohérence à ce recueil. En effet, la contradiction est partout ; les contraires se multiplient, se croisent, s’épousent et se bonifient : le « sucre » et le « sel », le noir et le blanc, l’ombre et la lumière, le centre et le contour, le silence et le son – des sons, pas des bruits – le minéral et le végétal, etc., et même les quatre saisons, dans le poème de la page 99, présentent une disposition plastique qui confirme cette opposition. Mais à cela s’ajoutent toujours les transitions, car l’approche de la contradiction chez Mandin n’est pas manichéenne : le « gris », que j’ai déjà signalé, est omniprésent ; il présente rarement une connotation péjorative, celle qu’il a pourtant dans l’imagination populaire, qui le met dans l’inutile. On peut également citer l’exemple du « tronc », qui est à la fois centre et contour, ou encore la pierre végétale. Ainsi naît, me semble-t-il, tout ce qui « touche » à la « nuance », à l’incertain, au « doute », aux « soupçons », tout un lexique très riche de l’inattendu : « ce qui ne s’attend pas / ce qui ne s’espère pas », nous dit le poète p. 37, et qui se déroule devant nos yeux. Le poète nous pousse à aborder l’insolite, nous invite à la création.
Ainsi chez Mandin, il n’y a pas de début, pas de fin, pas de majuscules, pas de virgules ; il y a ce qui se « déroule » et « s’enroule » dans le mouvement continu du langage poétique, dans l’anodin, dans l’émotion de la découverte et dans le non-dit de l’inutile. Certains motifs récurrents de l’œuvre semblent confirmer cette impression ; ainsi, l’utilisation de la valeur polysémique de l’ombre, par exemple, et je dirais même de ses valeurs polyphonique et « polychromatique », nous offre une ombre tantôt pure, humide, sensuelle, féminine, une quiétude recueillie et mouvante, tantôt une amante de la lumière, une atmosphère à découvrir, etc., ce « contenu de l’ombre » qu’il faut prendre et donner (p.111), comme l’écrivain le fait lui-même. L’utilisation redondante des « silences » fonctionne semblablement. « Elle disait les silences », écrit-il p. 25 – mais qui est Elle ? La langue ? Plus loin, page 39, cette interrogation stoïque : « Le silence sait donc se taire ? » N’avons nous pas là toute la problématique, en réunissant ces deux phrases, de la création poétique de Mandin, sous une forme métaphorique ?
Un autre aspect qui me paraît fondamental dans la démarche du poète vise à considérer tout ce qui a trait à une relation constamment recherchée, à une ouverture vers tout ce qui touche. Voilà pourquoi les regards et les sensations visuelles sont omniprésents, de même que la main, les regards sur le monde, la main qui écrit. Du reste, la « touche », chez Mandin, est à la fois un contact, une sensation tactile, mais elle peut toucher « l’ombre » et même le « contenu de l’ombre », comme un regard ! D’autre part la « touche » est aussi un élément pictural et plastique, qui font écho aux « constructions photographiques » de la fin du recueil, mais pas seulement. On constate en effet que l’auteur utilise un important vocabulaire renvoyant aux arts plastiques, qui n’est pas anodin : « touche », bien sûr, mais aussi « trait », « ligne », « outils du peintre », « dessin », « fusain », « cartons à dessins » – ceux-ci pourraient tout aussi bien devenir des « cartons à desseins », et tant d’autres. La « touche » est alors le complément symbolique de la langue, elle la fonde en partie. De plus, elle est souvent un moment privilégié, un artifice, sans le sens péjoratif, qui est destiné à susciter l’émotion, à l’image de l’admirable poème de la page 41 : « voilà le moment des ombres et des soupçons… / voilà le moment de la plénitude… / voilà le moment où l’inutile serait le bienvenu… » Dans ce désir irrépressible de toucher, on peut aussi remarquer un aspect original de l’utilisation de la ponctuation dans l’œuvre, c’est à dire des points, puisqu’il n’y a jamais de virgule. Les points sont, si je puis dire, des points ouverts ; l’interrogation, l’exclamation, la suspension…, donc des marques à la recherche, encore une fois, de la relation, une relation qui s’ouvre toujours davantage au fur et à mesure que l’on avance dans le recueil. La « ligne » devient « route », et enfin « delta ». De plus, l’absence du « je » n’empêche pas sa présence implicite (avec les désinences des verbes), mais le « tu » ou le « toi » et toutes les formes de la seconde personne du singulier (dont la plus grande proximité est évidente) sont employés explicitement, eux. De même, les tournures injonctives, qu’elles soient à l’impératif : « laisse l’inutile guider tes choix » (p. 27), ou à l’infinitif : « faire cesser… ne s’occuper… ne suivre » (p. 107), apparaissent régulièrement, tout comme les aphorismes, ce qui peut paraître étonnant dans un discours qui semble vouloir faire l’éloge de l’inutile. Mais l’humour, la dérision, le décalage sont aussi une des caractéristiques de l’écriture de ce poète, l’homophonie, les jeux de mots, les inversions, les calembours parsèment le discours d’une tonalité légère et amusée, où la pointe et l’ironie traduisent une certaine et touchante sympathie, au sens étymologique de ce mot. Par exemple, quand Mandin écrit : « les pieds en viennent aux rimes », le jeu de mots semble ironiser sur l’utilité (?) du vers traditionnel aujourd’hui.
Pour terminer, je voudrais dire le cheminement, dire Mandin, dire que je connais Mandin, et qu’il faut lire Mandin. Pour ce poète, il faut entendre ce qui ne s’entend pas, embrasser ce qui ne s’embrasse pas, toucher ce qui ne se touche pas, non pas parce que cela ne s’entend, ne s’embrasse ou ne se touche, mais parce que l’utile nous a habitués, sans doute, à ne pas le faire. On peut appliquer à Inutiles, et à la poésie de Mandin, cette réflexion du grand poète portugais Antonio Ramos Rosa :
« La construction du poème c’est la construction du monde »
(Respirer l’ombre vive, édition Lettres vives, traduction M Chandeigne).
Alors, cher poète, si vous me le permettez, je terminerai cette analyse en vous citant, en paraphrasant ce vers au détour d’une page perdue que vous retrouverez, j’en suis convaincu :
« suis heureux d’être… ce lecteur-là ! »
Claude TUYERAS
5 mars 2013